L’amour, un sentiment?
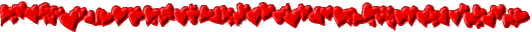
" L’amour n’est pas naturel; et le désir lui-même ne l’est pas longtemps.
Mais les sentiments vrais sont des œuvres "
(Alain, Propos sur le bonheur)
|
Table des matières
I. Confusion entre amour et sentiment
II. Le sentiment, composante essentielle de l'amour
III. Les sentiments ne sont pas auto-suffisants
IV. L'amour réside principalement dans la volonté
V. Le véritable amour est oblatif
|
I. Confusion entre amour et sentiment
1. On confond fréquemment amour et sentiment. Cette tendance est universelle: nous avons tous une propension
naturelle à réduire l’amour à sa composante sensible, ce qui revient encore à privilégier
la subjectivité. Il est question d’amour, pensons-nous, lorsque nous ressentons un attrait particulier pour
quelqu’un: un sentiment fort, une satisfaction intense, une certaine passion, un cœur vibrant, une douce émotion,
le plaisir d’être aux côtés de la personne aimée, de penser à elle... Certains
signes, toujours sensibles, nous persuadent que nous éprouvons un réel amour pour la personne concernée.
Ces symptômes disparaissent... et l’on pense que l’amour n’est plus.
2. Le thème abordé est vaste et la terminologie qui s'y rapporte fuyante. Les sentiments eux-mêmes
ne forment pas une catégorie homogène. Idéalement, on devrait les distinguer en fonction de
divers critères: leur origine, leur consistance ontologique, leur nature, leur valeur… L'état d'euphorie
ou la bonne humeur du fêtard sous l'emprise de l'alcool n'est pas comparable à la joie de retrouver
une personne aimée après une longue séparation. Un sentiment de fatigue peut pareillement
avoir une origine plus ou moins biologique ou psychique. Certains sentiments sont purement passifs - des états
d'âme que l'on subit largement…-, d'autres se présentent davantage comme des réponses affectives
conscientes. L'affectivité peut être dirigée vers une autre personne ou, plus précisément,
vers les sentiments subjectifs occasionnés par autrui. Cet aperçu sommaire ouvre un coin du voile
sur la complexité de l'univers des sentiments. Pour parler avec nuances de l'amour, il serait également
utile d'opérer de multiples distinctions: l'amour au sein de la famille (entre parents et enfants, entre
frères et sœurs…), l'amitié qui unit des personnes de même sexe (ou de sexe opposé),
l'amour entre époux, etc. Sans ignorer complètement toutes ces distinctions, mon propos se veut ici
beaucoup plus général.
II. Le sentiment, composante essentielle de l'amour
3. Il est vrai que le sentiment est une composante fondamentale de l’amour. Tout amour, si sublime et spirituel
soit-il, plonge des racines dans les profondeurs de la sensibilité. A y bien réfléchir, on
conviendra qu’en toute hypothèse le point de départ de l'amour est de l’ordre du sentiment: "
coup de foudre ", séduction irrésistible, attraction soudaine, appel du cœur... " Nihil
est in intellectu quod non prius fuerit in sensu ", dit l’adage classique. Il n’y a pas de solution de continuité
entre les impressions sensorielles et la vie de l’esprit. On ne peut tracer de frontière entre, d'une part,
les réalités sensibles et, d'autre part, les expériences "spirituelles". Il n'est
pas question d'établir un rapport d'opposition entre les sentiments et l'amour. Cela s’explique en raison
de l’intime union entre l’âme et le corps. L’homme est toujours indissociablement matière et esprit,
corps et âme; il est à la fois charnel et spirituel.
Il s’ensuit que notre vie sensitive — sentiments, émotions, passions... — n’est jamais comparable à
celle des animaux car elle appartient à un être doué de raison et de volonté et participe,
de quelque manière, de sa spiritualité. A l'inverse, on ne saurait occulter le nerf sensible de tout
amour, quelle que soit d'ailleurs sa nature. Puisqu’il s’agit d’une tendance de la personne tout entière
— qui n’est pas un pur esprit, mais une composition de corps et d’esprit —, il est crucial que l’amour puisse constamment
s’appuyer sur les ressorts de l’affectivité, se nourrir des sentiments, des émotions du cœur... Si
l’on ne met pas dans l'amour, quel qu'il soit, une part d’affection et de cœur, il n’est pas tout à fait
un amour humain.
III. Les sentiments ne sont pas auto-suffisants
4. Ceci dit, l’amour proprement humain réside principalement dans la volonté : il est un amour qui
procède d’un être spirituel, non simplement matériel. Par conséquent, il doit impliquer
toute la personne, avec ses facultés supérieures, sous peine de n’être qu’un ersatz de l’amour.
Ce n’est qu’ainsi que l’amour peut acquérir solidité et permanence, à l’abri des hauts et
des bas du sentiment.
Les sentiments — parce que tributaires des impressions sensorielles, multiples et diversifiées — sont, par
nature, changeants, versatiles : ils ne durent pas si ne demeure solide et ferme la volonté de maintenir
le cap, de demeurer fidèle. C’est surtout au niveau de la volonté que se joue la fidélité
à l’amour. En effet, l’enthousiasme, l’envie ne sont pas fiables en eux-mêmes. En d’autres termes,
les sentiments ne sont pas auto-suffisants : livrés à eux-mêmes, les amours naturels sont voués
à la dégénérescence.
La substance de l’amour ne peut être purement sentimentale, sous peine de se nier comme telle. On n’aperçoit
pas toujours suffisamment la part d’égoïsme que renferme le sentimentalisme. Survaloriser le sentiment,
c’est prêter une attention excessive à soi-même, en définitive, au plaisir procuré
par la compagnie et l’affection de l’autre: consciemment ou non, cette espèce d’amour cherche avant tout
sa satisfaction personnelle et non celle de l’autre, son plaisir et non celui de l’autre, son bien-être,
son épanouissement, sa propre réalisation... C’est de façon impropre que cette attitude est
regardée comme de l’amour.
En réalité, le sentimentalisme n'aime pas vraiment, il "use" d'autrui pour se procurer
une sensation subjective de satisfaction. L'expérience affective du sentimental ne porte pas tant sur la
personne aimée que sur ses propres sentiments et émotions suscités par elle.
Le véritable amour, au contraire, porte à sortir de soi et à s'identifier à l'autre.
Il fait sien les peines et les joies, les biens et les maux de l'autre, dont il cherche le bonheur et la satisfaction.
Un déplacement du centre de gravité de soi vers l'autre constitue la manifestation la plus authentique
de l'amour. Celui-ci se caractérise, en définitive, par un don de soi à l’autre. La personne
aimée est regardée comme un bien-en-soi et non comme un bien-pour-moi : elle est aimée pour
elle-même et non pour moi-même, pour le plaisir qu’elle me procure. Ces considérations ne sont
pas neuves, elles rejoignent la distinction classique entre amour de concupiscence (qui recherche, à travers
l’autre, son propre bien) et amour de bienveillance (qui recherche prioritairement le bien de l’autre).
IV. L'amour réside principalement dans la volonté
5. Généralement cette analyse est acceptée, mais on n’éprouve pas de sympathie pour
ses conséquences. En effet, il découle des développements précédents que l’envie,
l’enthousiasme, la passion, le plaisir propre, tout cela n’est pas décisif dans l’amour. L’absence ou la
disparition de ces sentiments est accessoire, l’important c’est que la volonté veuille. Il faut avouer que
pareille déduction n’exerce pas sur nous un grand pouvoir de séduction... Quand on parle d’amour,
on préfère décidément songer à la spontanéité, à la splendeur,
à la vitalité, à la fraîcheur des sentiments... L’amour évoque irrésistiblement
l’exubérance, la folle passion, les tendres émotions, les douces palpitations du cœur...
Pourtant, répétons-le, les amours sensibles, les sentiments, ne sont pas auto-suffisants: s’ils veulent
conserver leur force et leur douceur, il leur faut une aide extérieure, celle de la volonté, éclairée
par la raison. Dire cela ne revient pas à déprécier l’amour naturel mais, au contraire, à
indiquer où réside sa véritable grandeur.
Une métaphore, inspirée par C.S. Lewis, peut aider à comprendre le propos. Un jardin ne peut
pas pourvoir lui-même à son entretien; il lui faut une aide extérieure. Il a besoin du jardinier,
chargé de tailler les haies, arracher les mauvaises herbes, couper les rosiers, tondre le gazon... Ces soins
sont indispensables si l’on veut un jardin éclatant de fraîcheur et de beauté, qui continue
d’exister comme tel, sans se convertir en une quelconque broussaille. Les coups de sécateur contrarient
certes le développement spontané de la nature, mais ils font aussi la grandeur et la grâce
du jardin. Il est certain, au demeurant, que les éléments naturels — la terre, la sève des
plantes, la pluie, la lumière... —, par leur fraîcheur, leur fécondité... contribuent
nettement plus à la beauté du jardin que le jardinier, dont l’apport est mesquin par rapport à
celui de la nature elle-même. Cependant, la contribution du jardinier, modeste, ingrate, laborieuse, est
essentielle. Dans notre nature aussi, il y a des sentiments, des amours naturels, florissants, spontanés,
exubérants...: il convient pareillement que la volonté et l’esprit les habillent, les modèrent,
les soumettent à leur empire... A côté de la génialité de l’amour sensible, ces
facultés paraissent bien sèches et froides... leur office n’en est pas moins indispensable pour que
l’amour conserve sa grandeur, son éclat, sa pureté...
6. L'image proposée me permet de préciser encore et de nuancer le propos. Elle ménage incontestablement
une place de choix aux sentiments, aux appels du cœur…: ils constituent effectivement une part substantielle de
l'amour. Autrement dit, l'amour échappe en grande partie au centre spirituel de la personne. Le fait d'éprouver
un amour profond pour une autre personne est largement de l'ordre du don: les dispositions affectives de l'aimant
à l'égard de l'aimé s'imposent en quelque sorte au premier, dominent sa raison et sa volonté
libre. Elles se reçoivent comme un don gratuit dont l'origine est toujours un peu mystérieuse. Les
profonds sentiments d'affection voués à autrui proviennent des profondeurs de l'âme, d'un "lieu"
de la personne qui semble échapper à l'empire de la volonté. En ce sens, on peut rapporter
la célèbre maxime de Pascal: "Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas".
On peut citer aussi Montaigne: "Parce que c'était lui, parce que c'était moi", écrit-il
pour exprimer les motifs de son amitié pour E. de la Boétie.
Le philosophe Dietrich Von Hildebrand a bien mis cet aspect en lumière. Du point de vue moral, le dernier
mot revient à la volonté. Le "moi" réel réside dans la volonté. Mais,
sur d'autres terrains, c'est le cœur - plus que l'intelligence ou la volonté - qui constitue le noyau de
la personne, sa part la plus intime. Il en est ainsi au plan des amours humains: "l'amour est essentiellement
une voix du cœur". Nous estimons aimer une personne lorsque notre cœur - et pas seulement une décision
de la volonté - nous porte irrésistiblement vers elle. A l'inverse, nous espérons toucher
le cœur de la personne aimée: nous voulons que sa correspondance à notre affection suive aussi un
appel du cœur. Sa seule décision "volontariste" de nous aimer, de satisfaire nos désirs
ne suffit pas à nous persuader de son amour: nous voulons gagner son cœur. Ses efforts pour nous contenter,
sa sollicitude, ses marques d'affection, dictés par sa volonté, peuvent nous émouvoir et nous
édifier au plan moral, mais nous n'aurons pas le sentiment d'avoir vraiment "conquis" la personne
aimée tant que nous ne "possédons" pas son cœur, c'est-à-dire son centre réel.
Bref, dans une large mesure, et toute considération éthique mise à part, notre amour pour
autrui se reçoit gratuitement, coulant d'une source mystérieuse, plus qu'il ne se fabrique grâce
aux décrets de notre volonté libre. Un jardinier, aussi doué et résolu soit-il, sera
bien en peine d'aménager en plein désert un jardin verdoyant… Voire: il n'est pas impossible que
son labeur et sont entêtement ne soient finalement récompensés par la "découverte"
d'une source intarissable et pleine de promesses…
En même temps, nos expériences affectives n'expriment notre personnalité profonde que si elles
sont assumées par nos facultés supérieures (intelligence et volonté). Encore faut-il
consentir aux sentiments du cœur: un "oui" prononcé librement, une réponse personnelle
est indispensable pour que les bons sentiments éprouvés pour autrui se transforment en un amour qui
soit l'expression authentique et plénière de notre "moi" intime. L'amour vrai - et durable
- suppose normalement la présence de sentiments spontanés - qui jaillissent d'une source généreuse
et gratuite -, mais ceux-ci ne sont pas suffisants: un "oui" de tous les instants est également
nécessaire. Aussi l'amour, proprement humain, est-il toujours une affirmation décidée et positive
de la personne tout entière.
V. Le véritable amour est oblatif
7. Seul l’être humain est capable de rechercher consciemment et volontairement le bien de l’autre, en le
préférant à son bien propre. En ce sens, l’amour est l’apanage des personnes. Seul un amour
soumis à la raison et assumé par la volonté est vraiment digne de la personne aimante.
L’amour, ainsi défini, est également la seule attitude appropriée face à la personne
aimée. En effet, la personne est une fin-en-soi et, partant, doit être aimée pour elle-même
et non pas pour soi-même. Elle ne peut jamais être traitée comme simple moyen ou instrument
de satisfaction, d’épanouissement pour un autre. La conviction que l’autre est une personne amène
à accepter la subordination du sentiment, du plaisir propre, de la jouissance sexuelle à l’amour.
Ainsi compris, l’amour — faut-il le dire? — ne va pas de soi. Il suppose un effort, une maîtrise certaine
— les coups de sécateur... — pour contrarier, corriger une naturelle tendance utilitariste, " consumériste
", à l’égard de l’autre.
Cette conception personnaliste — suggérée notamment par K. Wojtyla dans Amour et responsabilité
— est aux antipodes de l’utilitarisme, dont la norme fondamentale repose sur le principe de " plaisir-déplaisir
", pour emprunter à la terminologie freudienne: chercher le maximum de plaisir, éviter au maximum
le déplaisir. S’il paraît naturel et légitime, un tel principe est néanmoins fragile.
Comment le plaisir peut-il être tenu pour le plus grand bien? Par essence, il est accessoire, ne se présentant
qu’à l’occasion de l’action. Organiser celle-ci seulement en vue du plaisir suppose de faire violence à
la nature profonde de l’homme. A moyen ou à long terme, pareil projet est voué à l’échec.
On sait que, souvent, les biens les plus appréciables ne sont atteignables qu’au prix d’un effort, supposent
une certaine peine, exigent le renoncement à des plaisirs immédiats... Le plaisir est toujours lié
à un acte concret; on ne peut donc l’évaluer à l’avance, ni le planifier: comment pourrait-il
être une valeur de premier ordre?
Les conséquences de l’utilitarisme - "hédoniste", si l'on veut - sont clairement désastreuses.
Si la recherche du plaisir est regardée comme le but premier de l’être humain, et son principal critère
de conduite, tout — la personne elle-même — apparaît dès lors comme un moyen servant à
atteindre ce but. A tenir ce principe pour généralisable, je dois me considérer moi-même
comme un moyen dont autrui peut se servir à ses propres fins de plaisir... Evidemment, en admettant que
le plaisir est le seul bien, je peux souhaiter procurer un maximum de plaisir à une autre personne. Cependant,
sauf à me contredire, je serai amené à renoncer à cette généreuse sollicitude
dès l’instant où celle-ci n’est plus une source de plaisir pour moi ou contrarie mon calcul de bonheur...
L’utilitarisme conduit à une impasse: la seule issue est de reconnaître en dehors du bien purement
subjectif, c’est-à-dire du plaisir, de la satisfaction propre, le bien objectif capable d’unir les personnes.
Se soumettre au bien de l’autre — moyennant l’aide de la volonté, éclairée par la raison —,
poursuivi aussi comme son propre bien, est le seul chemin pour se libérer de l’inévitable égoïsme
inhérent à l’utilitarisme.
Il doit être possible de parvenir, pour un temps, à une sorte d’équilibre subtil, plus ou moins
harmonieux, des égoïsmes en présence... Pour un temps seulement, car différents égoïsmes
sont, par essence, impossibles à harmoniser. Le véritable amour se rattache uniquement à la
norme personnaliste, jamais à la norme utilitariste. Ces deux normes sont à la base de deux attitudes
irréductibles: l’une consiste à tendre au seul plaisir, en lui subordonnant le bien objectif de l’autre,
traité comme objet; l’autre trouve la joie — et, en sus, le plaisir — dans l’effort pour se subordonner
au bien de l’autre et le traiter comme une personne. Par un naturel retour des choses, celui qui satisfait aux
exigences de l’amour, par le don désintéressé de lui-même, rejoint son propre bien et
atteint à la plénitude.
Étienne Montero.
![]()